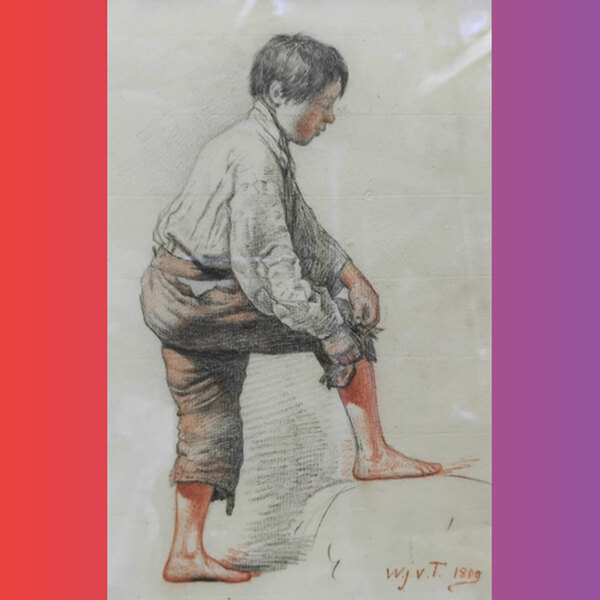Enfances interminables - Renaissances de l’art et du croire chez Jean-François Lyotard
Journées d’étude à l’occasion du centenaire de l’année de naissance de J-F Lyotard (1924-1998)
17.10.2024
Avant le performatif, il y a l’archi-performatif ; avant les paroles, cet immémorable et introuvable « instance » qui donne à penser, à parler. C’est ce que Jean-François Lyotard, dont nous commémorons cette année le centenaire de sa naissance, a appelé « l’enfance de la pensée ». Cette idée de « l'inchoative » qui, dans sa carrière de penseur, lui est venue un peu sur le tard, fait, après coup, écho à celle qui avait provoqué sa renommée, à savoir la notion de postmodernité. « Le postmoderne », selon sa formule, c’est « la modernité dans son berceau ». Il s'agit d'une in-fantia qui se déploie avant d'être captée par les figures et les formes du discours dont elle dépend néanmoins pour se faire entendre. Paradoxe inquiétant : ce qui ne parle ne peut venir à l’esprit que par la parole et la forme ? Figure d’une petitio principii, qui présuppose un silence parlant en parlant du silence ? Ou plutôt une expérience aporétique qui fait sentir ce qu’elle ne peut nommer ? De l’événement de la parole, née dans le silence et articulée d’une façon toujours trop tardivement, on doit conclure que ce moment lui-même de naissance ne peut se faire qu’en « se disant de multiples manières », comme d’ailleurs l’être heideggerien qui lui semble apparenté. Autrement dit, le naître de la parole inventée n’est-il pas l’équivalent de l’être qui s’invente à partir de sa naissance, son enfance ?
Ce qui s’invente en philosophie ne peut qu’apparaître dans les failles du système déjà articulé. L’ineffable émerge d’entre les lignes du déjà dit. Ainsi Kant avait-il inventé la notion du transcendantal – ni transcendance pure, ni immanence donnée. Ainsi Lyotard avait-il ouvert la faille entre discours et figure et celle entre les régimes des phrases, pour y faire émerger l’inarticulable comme ce qui donne vie et envie au penser, comme ce qui donne à penser. Transcendantal ou figural, critique ou différend, peu importe les indicateurs de ce moment de la naissance de la pensée et de la parole : leur disparité apparente et leur affinité relative signale un glissement du concept vers le nom propre, juste indicateur de ce qui ne se pense pas par moyen de captage, mais par l’écoute et l’accueil de cet ineffable qui donne à parler et à penser.
Pendant les deux journées d’étude organisées sous le titre Enfances interminables, la question de l’accueil de l’ineffable se pose dans ses deux dimensions, à savoir celle du croire (religieux) et celle de l’art (pictural ou musical). En parlant d’une « ontologie négative », Lyotard avait également suggéré une affiliation possible entre art et théologie. Chacun à sa manière fait l’effort de « sauver le nom », c’est-à-dire de donner la parole à ce qui ne parle pas, l’ineffable, l’enfance, l’événement, bref à cette source vitale de tout penser ou croire qui fait du bien. Curieusement, l’athée Jean-François Lyotard apparaît comme une sorte de penseur-protecteur de l’art du bien croire (ars bene credendi), d’une théologie post-doctrinaire et inventive qui apprend de l’œuvre artistique comment parler sans trahir l’ineffable. Dans des écrits peu discutés comme sa Confession d’Augustin et son Flora danica, Lyotard nous fait entrevoir et « entr’écouter » une alliance tacite qui se dessine entre le croire et l’art. Comment penser cette affinité ? Une nouvelle approche se dessine, aussi bien dans la théologie que dans l’art. Faire de la théologie, cela ne demande pas la déclaration dogmatique ni la proclamation herméneutique. Faire de la théologie, est un exercice inventif et interminable. Et l’activité artistique, à son tour, s’approche de plus en plus de de l’exercice spirituel. Les enfances lyotardiennes ne nourrissent pas aussi bien « l’art de croire à l’imprononçable » que « l’art de faire voir l’invisible » ?
Le colloque sur Lyotard, commémoratif et inventif à la fois, est organisé à l’initiative de la chaire de théologie libérale et inventive à l’Université Libre d’Amsterdam et de la chaire de philosophie et de philosophie éthique de la Luxembourg School of Religion & Society.
Pour consulter le programme, prière de cliquer ici