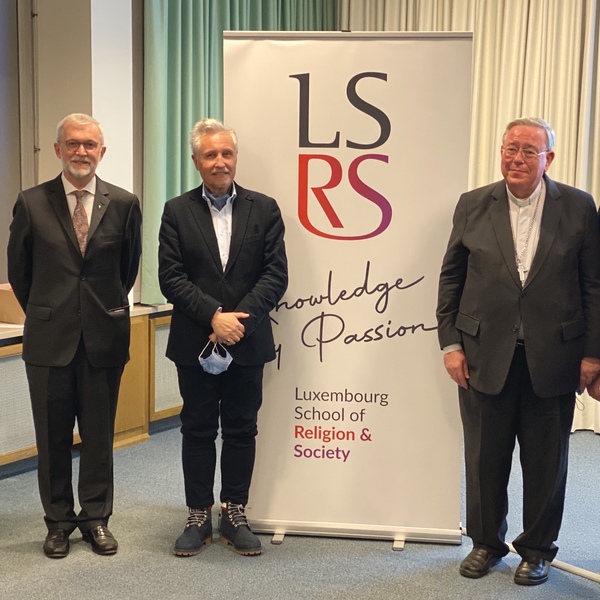Taillé dans la pierre : patrimoine religieux et espace public
Replay de la conférence par Dr Robert L. Philippart à la LSRS
« Taillé dans la pierre » renvoie à un caractère permanent et non éphémère, « patrimoine religieux » désigne les traces immobiles, sur le territoire de la capitale, qu’ont laissé les communautés catholiques, protestante et juive. En 1880, sur 209.000 résidents 207.000 étaient de confession catholique-romaine, 800 étaient juifs, 683 appartenaient aux communautés protestantes et réformées, 47 se déclaraient libre de toute confession. L’espace public requiert une définition précise de ce qu’il représente et surtout de sa gouvernance. Celle-ci devrait traduire la Souveraineté du peuple duquel émane tout pouvoir.
Le programme architectural
Parmi le patrimoine religieux on distingue différents types de construits : les églises et les chapelles, les écoles, les hôpitaux, des pensionnats, les scolasticae. Du côté monumental, on distingue les statues, les croix de chemins, les grottes de prière ou encore les inscriptions. Il est à noter qu’il n’est pas du devoir de la main publique d’ériger des monuments ou édifices ayant un caractère religieux ou pour le compte des communautés confessionnelles. Il est de leur devoir de garantir aux maîtres d’ouvrages la réalisation de leurs projets. Depuis la Constitution 1841, les droits à la liberté de culte et d’expression sont officiellement garantis. Dans une société inclusive et égalitaire, axée sur la recherche de la cohésion, de la tolérance et du respect, cette garantie vaut également pour la forme sculptée ou bâtie.
Le choix de l’emplacement
À jeter un regard sur la répartition du parc immobilier en relation avec l’exercice de la pratique religieuse catholique-romaine, on distingue pour le XIXe siècle trois zones spécifiques : le centre-ville regroupant les sièges de l’évêché et des consistoires pour répondre à ce besoin de réunir tous les pouvoirs civil, spirituel, économique et politique sur le territoire de la capitale. Les premières cliniques apparaissent également dans ces lieux qui attirent les masses. Les institutions religieuses établies au quartier de la gare suivent une mission socio-caritative en proposant des formations spécifiques pour filles. Elles attirent celles-ci de la campagne pour les former et leur assurer des débouchés dans la ville proche. Le Limpertsberg comptait 7 couvents. Ces couvents et maisons de retraite assuraient des présences éphémères, parce que ces communautés trouvaient au Luxembourg une terre d’asile face aux persécutions du Kulturkampf ou du combat laïciste. La communauté juive a à son tour trouvé au Luxembourg une nouvelle patrie, comme elle fuyait l’antisémitisme de leurs pays d’origine. Dès que la situation politique s’est accalmie, ces communautés religieuses retournaient dans leur pays.
Souvent un souci de rachat d’anciens terrains d’ancien couvents, nationalisés sous la Révolution Française expliquent le choix d’un terrain pour l’implantation d’un ordre religieux. Si l’institution avait besoin de grandes surfaces pour fonctionner, elle recherchait, tout comme l’industrie, des propriétés à la périphérie de la ville et dont les terrains n’étaient pas morcelés. L’absence de construction de nouveaux édifices s’explique aussi par le besoin général de l’époque de récupérer des immeubles relaissés comme bien nationaux ou en héritage de la garnison partie. La chapelle du Glacis marque une exception dans le sens qu’elle fut conçue pour accueillir les premiers évêques défunts et pour lesquels le statut juridique de la cathédrale n’autorisait pas l’inhumation.
École-église : un forum local
En raison du caractère confessionnel que détenait l’enseignement avant 1912, les écoles privées sont rares. Elles apparaissent quasiment exclusivement dans la formation des filles, dont l’absence de mixité dans les écoles publiques, présentait une certaine carence que ces établissements religieux voulaient palier. Les élèves furent obligés de suivre la messe en semaine, ce qui mena à la création de « forums » locaux, où se côtoyaient, parents et enfants de toutes couches sociales, où s’établirent des magasins, où on construisit du logement. La société à l’aube du XXe siècle fut divisée : les milieux libéraux se réunissant au Casino bourgeois, les associations catholiques non fondées sur les structures de la paroisse se retrouvaient au « Volkshaus », le monde féminin au « Veräinshaus » des Sœurs de Sainte Eilsabeth. La création de nouvelles paroisses entraîna la construction de 15 églises sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Statues, grottes et inscriptions
Dans la même lignée que l’industrie ou le commerce, et comme l’architecture de l’époque ne visualisait pas la fonction, des statues et inscriptions ornaient les façades. Ce furent Mercure et Fortune pour les uns, les Saints Protecteurs et Patrons des ordres et congrégations pour les autres. La question relève plutôt d’un « branding » que d’un souci missionnaire. Si la statue est protégée comme monument national, elle est publiquement reconnue pour son caractère identitaire, mais classé comme « monument », c’est-à-dire, comme témoin d’une époque, dans sa matérialité, sa qualité sculpturale. Le classement lui fait perdre son sens initial et la réduite à ses dimensions historique et matérielle. Comme le rapport au culte des Saints a changé suite à Vatican II et que la société est devenue laïque, ces représentations demeurent largement inidentifiables pour le grand public. La question du sens de ces protections mérite à être clarifiée.
Une question de style architectural
L’apparition du Modernisme dans l’architecture va mettre fin aux rêveries d’une société médiévale chrétienne idéalisée et promouvant le néo- gothique et le néo-roman. Le modernisme intègre les nouveaux matériaux et nouvelles techniques de construction et se place volontairement au-dessus de toute discussion sur l’histoire, le climat, la matérialité, les particularismes. Le mouvement liturgiste pourra trouver ses premiers champs d’essai sur le terrain.
Nécropoles et art funéraire
Les cimetières sont des espaces municipaux garantissant la liberté de choix d’être inhumé d’après ses propres convictions, surtout depuis la suppression des champs cultuels. On constate dans l’art funéraire du XIXe siècle, que plus une personne était croyante, plus elle insistait sur la représentation d’insignes religieux sur sa tombe. Les personnes moins sensibles à la question religieuse ont préféré combattre la mort par un monument rappelant leurs mérites et les valeurs qu’ils vivaient. Enfin, pour plusieurs membres des loges maçonniques, la nécropole leur devient une expression visible de leur adhésion à celles-ci.
Les communautés juives et protestantes
En 1880, la communauté protestante ne représentait que 683 étrangers travaillant au Luxembourg. Les Souverains du Grand-Duché de 1839 à 1912 étaient de confession protestante. Le pasteur était prédicateur à la Cour. L’ancienne église de la Sainte Trinité avait été mis à disposition de la communauté en 1817. En 1891 le Grand-Duc Adolphe y fit installer une loge grand-ducale pour pouvoir assister aux offices. Il finança également le presbytère protestant à Clausen. Jusqu’en 1916, la communauté avait droit à un champ cultuel propre sur les cimetières de la ville.
Tout comme les protestants, les membres de la communauté juive ne furent officiellement reconnus comme citoyens qu’à partir de la Révolution Française. Ils s’établirent par vagues successives au Luxembourg en s’installant d’abord dans des immeubles existants. Leur rabbin, Isaac Blumenstein, fut membre fondateur et très actif dans l’Alliance israélite universelle réclamant l’émancipation juive à tous les niveaux de la société. Dans cet ordre d’idées, il avait sollicité Ludwig Levy de construire une synagogue de style mauresque à Luxembourg. Or sur le terrain, la communauté ne reprit pas ce signal. Les investisseurs de confession juive préféraient le style international, démuni de tout insigne religieux. Il faut préciser que l’existence d’une statue catholique sur une propriété juive n’a pas induit le propriétaire à enlever celle-ci. La communauté juive, bénéficiant de ses propres rites autour de la mort, a pu exploiter deux cimetières privés, l’un à Clausen, l’autre à Bellevue. Les monuments sont largement identiques à ceux des cimetières municipaux, à la seule différence que l’insigne religieux soit adapté, l’hébreu utilisé en partie et les épitaphes plus développés. Le recours au style oriental est exceptionnel.
Dr Robert L. Philippart