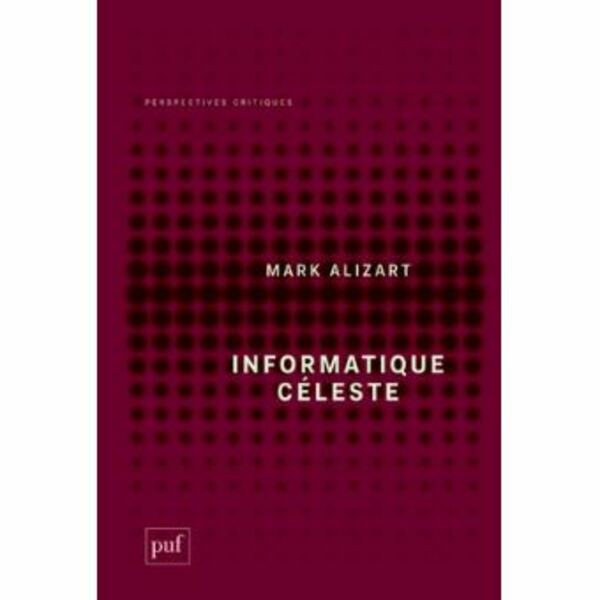Zoom sur le Colloque Rhétorique et économie du croire : Théologie inventive ll du 10 novembre 2023
Autour du projet de recherche « Ars bene credendi »
10.11.2023
Le projet de recherche Ars Bene Credendi : vers une théologie inventive se présente comme une collaboration entre la LSRS et la VU Amsterdam. Il a pour but d’explorer philosophiquement et théologiquement la possibilité d’une critique du croire. Cela l’amène à scruter la culture actuelle et soi-disant désenchantée, pour y faire émerger le croire persistant en dehors de ses articulations religieuses. À la suite de la journée d’études Rhetoric and the Politics of Believing qui s’est tenue à Amsterdam en 2022, une deuxième a eu lieu le 10 novembre 2023 à la LSRS. Sous le titre Rhétorique et économie du croire, un collectif de chercheurs en théologie s’est penché sur les conventions (« lois » : nomos) qui donnent de la cohérence au vivre ensemble (« maison » : oikos, maison) mais risquent également d’éteindre cette vie.
Le philosophe et publiciste Mark Alizart (Paris), invité principal, a ouvert les échanges. S’appuyant sur les méthodes des cultural studies, Alizart explore les conditions de possibilité d’un croire sous un ciel radicalement sécularisé. Dans ses livres Pop théologie et Informatique céleste, il a élargi la thèse de Max Weber sur le rapport entre protestantisme et capitalisme. Il soutient que non seulement l’économie, mais toute la culture moderne est animée par l’éthique protestante, c’est-à-dire par l’ascèse intramondaine. Par exemple : l’art moderne se définit par son auto-effacement ; comme pour Luther tout homme était prêtre, pour Josef Beuys tout homme est peintre. Ce retrait de l’homme ouvre l’espace pour le surhomme nietzschéen. C’est ici que technologie et théologie se touchent : l’ordinateur réalise la conception « économique » de la théologie, résumée dans le concept du deus ordinator. Si, comme Hegel le soutenait, l’esprit se réalise en phénomène, alors c’est dans la cybernétique et l’informatique qu’il est en œuvre. Dans nos sociétés, le croire culmine dans le self-belief. Avec Luther, on peut parler aujourd’hui effectivement de la fides creatrix divinitatis, non in substantia dei, sed in nobis. C’est par sa foi que le croyant théo-technologique se crée soi-même en position de divinité.
Knut Wormstädt (Universität Aachen) a critiqué le concept d’anthropocène. Si les problèmes écologiques sont causés par la technique, l’optimisme technologique et le pessimisme anti-technologique sont naïfs. Pour survivre écologiquement, il faut que l’homme apprenne à vivre dans le « chthulucène », néologisme que Donna Haraway propose pour exprimer que l’homme fait intégralement partie de son milieu et que, pour survivre, tous les terrestres devraient coopérer au-delà de la distinction entre culture et nature.
La performance artistique Verantwort:ich, montée à l’occasion de la rencontre synodale à la cathédrale de Francfort-sur-le-Main (23 mars 2023), a inspiré Judith Gruber (KU Leuven) pour penser le rituel ecclésiastique « auto-sacralisant ». Elle a opté pour une appartenance fluide et inclusive. Cela exige que la justification transcendantale soit remplacée par un récit théologique qui place au centre un dieu participant aux souffrances humaines.
La question de l’invention historique d’une Église a été abordée par Marius van Hoogstraten (Vrije Universiteit Amsterdam). En faisant une lecture de l’archi-histoire des anabaptistes, il a proposé que les premières assemblées anabaptistes n’étaient pas des « églises ». Elles ne cherchaient pas le retrait ascétique de la sphère publique. Elles avaient la volonté de créer un vivre-ensemble en liberté, donc, pour parler avec les mots de Hannah Arendt, une réalité politique et publique.
Ryszard Bobrowicz (KU Leuven) s’est penché sur le paradoxe que l’invention demande au sein de l’ordre réglé de l’espace « dissensuel ». Avec les concepts de « résonance » (H. Rosa) et d’« anti-fragile » (Taleb), il a montré la nécessité d’un trajet de négociation permanente : trop de rigidité et d’uniformité met la survie d’un système à risque. Il faut en revanche un dissensus communicationnel qui accepte l’adage de Rosenstock-Huessy: respondeo etsi mutabor, je réponds, même si cela me changera.
Aidé par les réflexions de Paul Ricoeur sur la reconnaissance, Richard Gossin (Université de Strasbourg) a dessiné une théologie de l’entre-deux. Une telle théologie demande du respect pour l’espace ouvert, espace de médiation entre l’homme et son dieu. Ni une théologie positive, qui fait que l’homme sait trop de dieu, ni une théologie négative qui place dieu à une distance insurmontable, mais une théologie de va-et-vient dans une relation à la fois de réciprocité et de dissymétrie. Dans ce contexte, il a repris la figure du Zimzum de la mystique juive : pour pouvoir entrer en contact, il faut que Dieu et de l’homme sachent s’évader et se retirer.
Alberto Ambrosio (LSRS) a développé une idée théologique de la mode, à partir d’un court-circuitage fructueux entre l’économie du marché et l’esthétique vestimentaire. La consommation, à notre époque, va au-delà d’un simple échange ou investissement financier. Elle a un statut ontologique, eschatologique et donc théologique : la mode implique un changement performatif de l’être de la personne. Consommer, c’est (se) sacrifier pour renaître à nouveau.
Une conversation interactive avec Mark Alizart sur son trajet intellectuel et personnel a clôturé cette journée.